So british, par Ingannmic.
J'aime bien Kate Atkinson.
So british, par Ingannmic.
 Wesley Stace est aussi connu comme chanteur folk sous le pseudonyme de John Wesley Harding (il a joué avec Springsteen et Joan Baez). De Miss Fortune, une de ses chansons, il a fait un roman « Misfortune », titre traduit en français par « L’infortunée ». Il lui a fallu 6 années pour écrire le destin de Miss Fortune, un nouveau-né garçon recueilli par l’homme le plus riche d’Angleterre et élevé comme une fille. L’histoire débute en 1823, dans un quartier de Londres miséreux et crasseux. Un bébé est abandonné dans une décharge de la ville mais par un heureux concours de circonstance incarné par un chien, il est trouvé par Geoffroy Loveall, fils unique de Lady Loveall, une vieille mégère qui attend désespérément que son fils perpétue la lignée. Geoffroy, inconsolable de la mort de sa sœur Dolores, vivant en reclus, elle attend depuis fort longtemps. Geoffroy emmène le bébé et décide de l’appeler Rose et d’en faire son héritière. Problème : le nourrisson est un garçon. Geoffroy le nie et décide de l’élever comme une fille ce qui ne va pas sans complications dans l’Angleterre victorienne. Surtout avec une famille de rapaces qui n’attendent qu’un faux pas pour mettre la main sur le colossal héritage des Loveall.
Wesley Stace est aussi connu comme chanteur folk sous le pseudonyme de John Wesley Harding (il a joué avec Springsteen et Joan Baez). De Miss Fortune, une de ses chansons, il a fait un roman « Misfortune », titre traduit en français par « L’infortunée ». Il lui a fallu 6 années pour écrire le destin de Miss Fortune, un nouveau-né garçon recueilli par l’homme le plus riche d’Angleterre et élevé comme une fille. L’histoire débute en 1823, dans un quartier de Londres miséreux et crasseux. Un bébé est abandonné dans une décharge de la ville mais par un heureux concours de circonstance incarné par un chien, il est trouvé par Geoffroy Loveall, fils unique de Lady Loveall, une vieille mégère qui attend désespérément que son fils perpétue la lignée. Geoffroy, inconsolable de la mort de sa sœur Dolores, vivant en reclus, elle attend depuis fort longtemps. Geoffroy emmène le bébé et décide de l’appeler Rose et d’en faire son héritière. Problème : le nourrisson est un garçon. Geoffroy le nie et décide de l’élever comme une fille ce qui ne va pas sans complications dans l’Angleterre victorienne. Surtout avec une famille de rapaces qui n’attendent qu’un faux pas pour mettre la main sur le colossal héritage des Loveall.La croisière s'amuse... vraiment? Par Sandrine
 L'idée du livre surprise était assez rigolote, le tout étant évidemment d'avoir un pseudo et un jour de naissance s'accordant chanceusement. Pour moi, en résumé et partout où j'ai pu faire l'essai S +16 = Sagan, invariablement... J'ai donc été tentée de ne pas participer à l'activité d'octobre, en effet ma période Sagan remonte à une quinzaine d'années et fut assez remplie. Tentation grande mais la honte de lâcher mes camarades de jeux fut plus forte et me voici donc avec mon Sagan! Petite entorse à la règle, j'en ai pris un de mon énooorme PAL (le seul non lu durant la période susnommée pour cause de trop de pages (562).
L'idée du livre surprise était assez rigolote, le tout étant évidemment d'avoir un pseudo et un jour de naissance s'accordant chanceusement. Pour moi, en résumé et partout où j'ai pu faire l'essai S +16 = Sagan, invariablement... J'ai donc été tentée de ne pas participer à l'activité d'octobre, en effet ma période Sagan remonte à une quinzaine d'années et fut assez remplie. Tentation grande mais la honte de lâcher mes camarades de jeux fut plus forte et me voici donc avec mon Sagan! Petite entorse à la règle, j'en ai pris un de mon énooorme PAL (le seul non lu durant la période susnommée pour cause de trop de pages (562).Mitigé, par Ingannmic.
 Dans un monde dévasté, recouvert de cendres, cheminent un homme et son fils ("le petit"). Toutes leurs possessions sont entreposées dans un caddie qu'ils trainent avec eux. Les villes, pillées depuis des années, semblent désertes, toute végétation a disparu. De temps en temps, l'homme et l'enfant trouvent sur leur route des restes de cadavres calcinés. Ils croisent en revanche peu de vivants, et évitent tous contacts avec eux.
Dans un monde dévasté, recouvert de cendres, cheminent un homme et son fils ("le petit"). Toutes leurs possessions sont entreposées dans un caddie qu'ils trainent avec eux. Les villes, pillées depuis des années, semblent désertes, toute végétation a disparu. De temps en temps, l'homme et l'enfant trouvent sur leur route des restes de cadavres calcinés. Ils croisent en revanche peu de vivants, et évitent tous contacts avec eux. Mon livre surprise est une sorte d'autobiographie fictive. À l’aide des livres déjà parus sur le sujet, Nicole Avril est entrée dans la peau de Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch) qui raconte sa vie avec Picasso (Pablo Ruiz Picasso). L’histoire de Dora Maar c’est l’histoire d’une femme effacée. Quand elle rencontre Picasso en 1936 elle peint, elle est photographe, elle fait partie d’un groupe dit radicaliste, elle a des amis. Dora vit un amour fou et quand c’est fini en 1943 et que Picasso choisit une autre muse, il ne reste plus rien d’elle. Pour la reste de sa vie elle ne sera que l’ex-maîtresse de Picasso ; pour son entourage mais aussi pour elle-même parce qu’elle n’arrive pas à guérir de cet homme qu’elle a aimé comme on aime un dieu. Ce n’est pas étonnant qu’elle fuit dans la religion comme une noyée qui cherche une bouée de sauvetage.
Mon livre surprise est une sorte d'autobiographie fictive. À l’aide des livres déjà parus sur le sujet, Nicole Avril est entrée dans la peau de Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch) qui raconte sa vie avec Picasso (Pablo Ruiz Picasso). L’histoire de Dora Maar c’est l’histoire d’une femme effacée. Quand elle rencontre Picasso en 1936 elle peint, elle est photographe, elle fait partie d’un groupe dit radicaliste, elle a des amis. Dora vit un amour fou et quand c’est fini en 1943 et que Picasso choisit une autre muse, il ne reste plus rien d’elle. Pour la reste de sa vie elle ne sera que l’ex-maîtresse de Picasso ; pour son entourage mais aussi pour elle-même parce qu’elle n’arrive pas à guérir de cet homme qu’elle a aimé comme on aime un dieu. Ce n’est pas étonnant qu’elle fuit dans la religion comme une noyée qui cherche une bouée de sauvetage.Cauchemar partagé, par Ingannmic.
 Parce que vous avez naïvement lu la 4ème de couverture, vous croyez que vous allez vous plonger dans une sombre histoire de meurtres en série... et puis R.J. Ellory vous prend par la main pour, tout doucement, vous faire partager l'intimité de son héros et narrateur, Joseph Vaughan. Attention, cela n'empêche pas cette histoire d'être sombre, l'existence de Joseph semblant n'être qu'un interminable cauchemar dont il ne parvient pas à s'échapper, et qui englue le lecteur. En effet, il perd, dans diverses circonstances, tous les êtres qui lui sont chers, et porte en lui l'écrasante culpabilité de n'avoir pu empêcher l'assassinat d'une dizaine de fillettes dont il fut plus ou moins proche étant enfant puis adolescent. A cette époque, il vit à Augusta Falls -Géorgie- et la seconde guerre mondiale fait entendre son triste et lointain écho depuis l'Europe. En digne population de petite ville, celle d'Augusta Falls, traumatisée par le meurtre de ses enfants et aveuglée par la peur, fait preuve de méfiance et d'injustice envers ceux qui sont différents. Et Joseph l'est, différent. L'éducation qu'il a reçue de sa mère et l'attention que lui prodigue son institutrice lui ont permis de développer son ouverture d'esprit, et ces deux femmes vont de plus l'encourager à s'engager sur la voie de l'écriture pour laquelle il a de sérieuses prédispositions. Autant d'éléments qui peuvent être considérés comme des qualités, mais qui font de lui un être particulier aux yeux de concitoyens ignorants et hypocrites.
Parce que vous avez naïvement lu la 4ème de couverture, vous croyez que vous allez vous plonger dans une sombre histoire de meurtres en série... et puis R.J. Ellory vous prend par la main pour, tout doucement, vous faire partager l'intimité de son héros et narrateur, Joseph Vaughan. Attention, cela n'empêche pas cette histoire d'être sombre, l'existence de Joseph semblant n'être qu'un interminable cauchemar dont il ne parvient pas à s'échapper, et qui englue le lecteur. En effet, il perd, dans diverses circonstances, tous les êtres qui lui sont chers, et porte en lui l'écrasante culpabilité de n'avoir pu empêcher l'assassinat d'une dizaine de fillettes dont il fut plus ou moins proche étant enfant puis adolescent. A cette époque, il vit à Augusta Falls -Géorgie- et la seconde guerre mondiale fait entendre son triste et lointain écho depuis l'Europe. En digne population de petite ville, celle d'Augusta Falls, traumatisée par le meurtre de ses enfants et aveuglée par la peur, fait preuve de méfiance et d'injustice envers ceux qui sont différents. Et Joseph l'est, différent. L'éducation qu'il a reçue de sa mère et l'attention que lui prodigue son institutrice lui ont permis de développer son ouverture d'esprit, et ces deux femmes vont de plus l'encourager à s'engager sur la voie de l'écriture pour laquelle il a de sérieuses prédispositions. Autant d'éléments qui peuvent être considérés comme des qualités, mais qui font de lui un être particulier aux yeux de concitoyens ignorants et hypocrites. Voici donc mon "livre-surprise". Qui fut une vraie... surprise ! D'abord de tomber sur ce titre, qui m'a intrigué et qui m'a donné envie de le lire. L'histoire est on ne peut plus simple, et pourtant tellement compliquée... Le résumé ne dépasse pas cela : le personnage principal, Cooper, attend sa soeur. Point. Mais il ne l'attend pas juste un instant, juste pour un rendez-vous... Non, Cooper passe sa vie à attendre sa soeur. C'est son activité principale. Il a pourtant bien un métier et un semblant de vie sociale, rien de plus classique, mais il s'en contente uniquement comme activités parallèles à son attente. L'histoire de Cooper c'est l'histoire d'un amour incestueux, celle d'un homme qui ne vit que pour une autre. C'est l'histoire de l'absence, et celle de la solitude et de la déchéance. Il nous parle aussi du monde moderne, des relations de travail et familiales.
Voici donc mon "livre-surprise". Qui fut une vraie... surprise ! D'abord de tomber sur ce titre, qui m'a intrigué et qui m'a donné envie de le lire. L'histoire est on ne peut plus simple, et pourtant tellement compliquée... Le résumé ne dépasse pas cela : le personnage principal, Cooper, attend sa soeur. Point. Mais il ne l'attend pas juste un instant, juste pour un rendez-vous... Non, Cooper passe sa vie à attendre sa soeur. C'est son activité principale. Il a pourtant bien un métier et un semblant de vie sociale, rien de plus classique, mais il s'en contente uniquement comme activités parallèles à son attente. L'histoire de Cooper c'est l'histoire d'un amour incestueux, celle d'un homme qui ne vit que pour une autre. C'est l'histoire de l'absence, et celle de la solitude et de la déchéance. Il nous parle aussi du monde moderne, des relations de travail et familiales. On me demande parfois, souvent... comment je fais pour différencier une œuvre de littérature autobiographique d'un témoignage, pour distinguer la frontière souvent poreuse entre les deux. Alors je me noie dans des explications un brin longuettes et un peu pataudes afin de masquer mon embarras, afin de contourner une vérité un peu abstraite et si difficile à argumenter... à savoir que ce qui différencie une œuvre d'art d'une chaise à bascule, c'est tout bêtement son style. Le dernier (l'ultime ?) livre de François Nourissier en sera ma preuve irréfutable, mon joker imparable, celui que je sortirai de mon chapeau lorsqu'on ne me croira pas. Sans rire (on y rigole d'ailleurs très peu) : si vous vous demandez comment différencier la littérature autobiographique du témoignage pipole (ou non), on vous recommandera la lecture d' « Eau-de-feu », dont le seul titre, poétique, claquant... dit déjà tout. S'il s'était appelé « Ma femme est une alcoolique en phase terminale et je suis très malheureux », on aurait eu évidemment plus de doutes. Ce n'est pas le cas et l'on s'en réjouit. Carrément : lorsque l'expérience autobiographique se métamorphose en littérature et tend (donc) vers le Beau, oui, on a le droit de se réjouir du malheur des autres.
On me demande parfois, souvent... comment je fais pour différencier une œuvre de littérature autobiographique d'un témoignage, pour distinguer la frontière souvent poreuse entre les deux. Alors je me noie dans des explications un brin longuettes et un peu pataudes afin de masquer mon embarras, afin de contourner une vérité un peu abstraite et si difficile à argumenter... à savoir que ce qui différencie une œuvre d'art d'une chaise à bascule, c'est tout bêtement son style. Le dernier (l'ultime ?) livre de François Nourissier en sera ma preuve irréfutable, mon joker imparable, celui que je sortirai de mon chapeau lorsqu'on ne me croira pas. Sans rire (on y rigole d'ailleurs très peu) : si vous vous demandez comment différencier la littérature autobiographique du témoignage pipole (ou non), on vous recommandera la lecture d' « Eau-de-feu », dont le seul titre, poétique, claquant... dit déjà tout. S'il s'était appelé « Ma femme est une alcoolique en phase terminale et je suis très malheureux », on aurait eu évidemment plus de doutes. Ce n'est pas le cas et l'on s'en réjouit. Carrément : lorsque l'expérience autobiographique se métamorphose en littérature et tend (donc) vers le Beau, oui, on a le droit de se réjouir du malheur des autres. Canicule à Oslo...
Canicule à Oslo... La brigade criminelle du commissaire Sandoval a fort à faire en ce mois de septembre. Des cadavres de femmes sont retrouvés amputés d'une main, point de départ d'une enquête compliquée, sur fond de trafic de viande et de faux papier. L'un des inspecteurs chargés des investigations est préoccupé par une situation familiale difficile, la juge qui travaille sur l'affaire semble quant à elle avoir des démêlés avec un ex-conjoint top pressant... en découvrant le nombre de ramifications, de rebondissements, de personnages sur lesquels s'attarde l'auteur, on se dit que ce roman aurait pu se métamorphoser en un indescriptible fouillis... eh bien non !
La brigade criminelle du commissaire Sandoval a fort à faire en ce mois de septembre. Des cadavres de femmes sont retrouvés amputés d'une main, point de départ d'une enquête compliquée, sur fond de trafic de viande et de faux papier. L'un des inspecteurs chargés des investigations est préoccupé par une situation familiale difficile, la juge qui travaille sur l'affaire semble quant à elle avoir des démêlés avec un ex-conjoint top pressant... en découvrant le nombre de ramifications, de rebondissements, de personnages sur lesquels s'attarde l'auteur, on se dit que ce roman aurait pu se métamorphoser en un indescriptible fouillis... eh bien non ! Ce livre est encensé , vilipendé … moi il m’a émue, chavirée, interloquée, abasourdie, laissée pantelante...
Ce livre est encensé , vilipendé … moi il m’a émue, chavirée, interloquée, abasourdie, laissée pantelante...  de son vocabulaire, ses envolées, ses trouvailles …270 pages de pur bonheur
de son vocabulaire, ses envolées, ses trouvailles …270 pages de pur bonheur Quand on écrit (un roman) sur la vie des animaux, c'est difficile de ne pas céder à l'anthropomorphisme. C'est probablement même impossible. Comment savoir vraiment ce que pensent les animaux, ce qu'ils ressentent ?
Quand on écrit (un roman) sur la vie des animaux, c'est difficile de ne pas céder à l'anthropomorphisme. C'est probablement même impossible. Comment savoir vraiment ce que pensent les animaux, ce qu'ils ressentent ? Voilà, j'y suis. J'ai choisi une grande librairie, en me disant que des auteurs dont le nom commence par i, il ne doit pas y en avoir pléthore. Voyons : Ionesco,..., Irving, Irving, Irving, (oh, non, pas lui),..., Ishiguro... ça y est, 28, et le hasard fait bien les choses, puisque c'est le dernier roman à la lettre i ! "And the winner is..." : "Pop Heart" de Barbara Israël. Connais pas. Au moins, c'est vraiment une surprise. Et en plus, c'est un premier roman.
Voilà, j'y suis. J'ai choisi une grande librairie, en me disant que des auteurs dont le nom commence par i, il ne doit pas y en avoir pléthore. Voyons : Ionesco,..., Irving, Irving, Irving, (oh, non, pas lui),..., Ishiguro... ça y est, 28, et le hasard fait bien les choses, puisque c'est le dernier roman à la lettre i ! "And the winner is..." : "Pop Heart" de Barbara Israël. Connais pas. Au moins, c'est vraiment une surprise. Et en plus, c'est un premier roman. Ce livre ne pouvait qu’être, dans mes lectures la continuité de la lecture de celui d’Henry Bauchau, « L’enfant bleu ».
Ce livre ne pouvait qu’être, dans mes lectures la continuité de la lecture de celui d’Henry Bauchau, « L’enfant bleu ».
Je ne connaissais de Jean-Louis Fournier que le trublion, producteur et réalisateur de « La Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède », avec Pierre Desproges. Je ne connaissais pas l’auteur de déjà quelques vingt-trois ouvrages. Personne n’est parfait surtout quand on regarde le titre des certains des essais publiés : « La grammaire française et impertinente » (1992), « L'arithmétique appliquée et impertinente » (1993), « Peinture à l'huile et au vinaigre » (1994) ou encore « Je vais t'apprendre la politesse, p'tit con » (1998) et un petit dernier titre « A ma dernière cigarette » (2007).
Pierre Desproges, son ami, l’a accompagné dans une de ses visites. « Il n’avait pas beaucoup envie », l’auteur avait « insisté ». Pierre Desproges, « cette visite l’a beaucoup remué », « lui qui adorait l’absurde, il avait trouvé des maîtres. »Jean-Louis Fournier évoque à mots couverts, Marie, qui « a raconté à ses camarades d’école qu’elle avait deux frères handicapés. Elles n’ont pas voulu la croire. Elles lui ont dit que ce ‘n'était pas vrai, qu’elle se vantait. » Comme si on pouvait se vanter d’avoir deux frères « avec de la paille dans la tête ».
Il nous parle aussitôt de Josée, la femme qui eut la charge de Thomas et Mathieu pendant quelques temps : « Pourquoi, Josée, avez-vous jeté les enfants par la fenêtre ? ». Regard interloqué de la femme. « Ce n'est pas bien, Josée, ce que vous avez fait. Je sais bien qu'ils sont handicapés, ce n'est pas une raison pour les jeter ».La symphonie des « Si vous étiez comme les autres, je vous aurais… » (pages 106 à 108) se termine par la terrible conclusion « On l’a échappé belle. ».
Cet opus retrace certains épisodes de leur vie commune, par des chapitres très brefs.Tout cela nous fait réfléchir et va nous obliger à regarder autrement les autres, ceux parfois pour lesquels on détourne la tête.
« Grâce à eux, j’ai eu des avantages sur les parents d’enfants normaux. Je n’ai pas eu de soucis avec leurs études ni leur orientation professionnelle. Nous n’avons pas eu à hésiter entre filière scientifique et filière littéraire. Pas eu à nous inquiéter de savoir ce qu’ils feraient plus tard, on a su rapidement que ce serait : rien.Et surtout, pendant de nombreuses années, j’ai bénéficié d’une vignette automobile gratuite. Grâce à eux, j’ai pu rouler dans des grosses voitures américaines. »
Terribles phrases qui doivent nous faire réfléchir et nous faire tendre la main.Ne soyons pas si cyniques et rendons le sourire que ces enfants, jeunes et adultes dit handicapés nous font ; ils n’ont pas de prix ; ils sont gratuits et nous réchauffent le cœur.
Et pour avoir un autre éclairage, aller sur le site de la maman de ces enfants appartenant au peuple du désastre.
 Zaph a parfois de drôles d’idée. La dernière en date a conduit les chats vers la lecture du livre surprise. A partir d’un principe très simple (le livre surprise dépend du hasard, hasard incarné par la première lettre du pseudo et la date de naissance), il a réussi à transformer ma vie de chat (paresseux) en enfer. Dans la première librairie que j’ai visitée, à la lettre L se trouvait le « Goût du bonheur », la trilogie romanesque de Marie Laberge. Et c’était par le tome 2 que j’aurais du commencer. 949 pages pour ce tome (tout de même) et 2 929 pages pour la saga. J’ai baissé les bras. Zaph le fourbe autorisant un minimum de tricherie, direction le rayon SF où s’offre à moi le tome 3 d’un cycle de Mercedes Lackey chez Milady ... et, bien entendu, pas de tome 1 en vue. Mon salut viendra de la bibliothèque municipale et de « Juillet » de Marie Laberge. Il est écrit que je n’échapperai pas au romanesque de Marie Laberge pour cette activité.
Zaph a parfois de drôles d’idée. La dernière en date a conduit les chats vers la lecture du livre surprise. A partir d’un principe très simple (le livre surprise dépend du hasard, hasard incarné par la première lettre du pseudo et la date de naissance), il a réussi à transformer ma vie de chat (paresseux) en enfer. Dans la première librairie que j’ai visitée, à la lettre L se trouvait le « Goût du bonheur », la trilogie romanesque de Marie Laberge. Et c’était par le tome 2 que j’aurais du commencer. 949 pages pour ce tome (tout de même) et 2 929 pages pour la saga. J’ai baissé les bras. Zaph le fourbe autorisant un minimum de tricherie, direction le rayon SF où s’offre à moi le tome 3 d’un cycle de Mercedes Lackey chez Milady ... et, bien entendu, pas de tome 1 en vue. Mon salut viendra de la bibliothèque municipale et de « Juillet » de Marie Laberge. Il est écrit que je n’échapperai pas au romanesque de Marie Laberge pour cette activité. Lors d'une visite au camp de concentration de Buchenwald où il accompagne ses élèves, un professeur découvre sur une photographie un détenu qui ressemble à s'y méprendre à son propre père. Troublé, il entreprend des recherches qui vont le mener sur le double chemin de son histoire familiale et de la folie nazie.
Lors d'une visite au camp de concentration de Buchenwald où il accompagne ses élèves, un professeur découvre sur une photographie un détenu qui ressemble à s'y méprendre à son propre père. Troublé, il entreprend des recherches qui vont le mener sur le double chemin de son histoire familiale et de la folie nazie.Tout ça pour ça, par Thom.
 Jay McInerney a publié il y a déjà un paquet de temps “Bright Lights, Big City”, remarquable roman dont le héros, Dorian Gray moderne, peut tout à fait être vu comme un cousin du Patrick Bateman de Bret Easton Ellis.
Jay McInerney a publié il y a déjà un paquet de temps “Bright Lights, Big City”, remarquable roman dont le héros, Dorian Gray moderne, peut tout à fait être vu comme un cousin du Patrick Bateman de Bret Easton Ellis. Ce sont ses personnages qui font de "Bad City Blues" un roman intense et atypique...
Ce sont ses personnages qui font de "Bad City Blues" un roman intense et atypique... Un homme rentre d'un pays en guerre, où il était mercenaire, dans son village du sud de la France. Sans doute s'est-il perdu lors de son absence, puisqu'il ne parvient pas à reconnaître ce village comme le sien, ni à se retrouver tel qu'il était auparavant. Il se sent étranger, lointain. Alors, dans une tentative pour renouer avec lui-même, il refait maintes fois les gestes d'avant, reprend quelques anciennes habitudes, évoque ses souvenirs, notamment celui de Magali, son flirt adolescent...
Un homme rentre d'un pays en guerre, où il était mercenaire, dans son village du sud de la France. Sans doute s'est-il perdu lors de son absence, puisqu'il ne parvient pas à reconnaître ce village comme le sien, ni à se retrouver tel qu'il était auparavant. Il se sent étranger, lointain. Alors, dans une tentative pour renouer avec lui-même, il refait maintes fois les gestes d'avant, reprend quelques anciennes habitudes, évoque ses souvenirs, notamment celui de Magali, son flirt adolescent... Née en 1901 dans une famille d’intellectuels, étudiante à Cambridge, Rosamond Lehmann est révélée en 1927 par Poussière, archétype du roman d’apprentissage, évocation pleine d’ambiguïté des souffrances et des amours de l’adolescence. Proche du Bloomsbury Group, auteure de L’Invitation à la valse, La Ballade et La source, elle sera l’une des grandes figures de la littérature anglaise ;
Née en 1901 dans une famille d’intellectuels, étudiante à Cambridge, Rosamond Lehmann est révélée en 1927 par Poussière, archétype du roman d’apprentissage, évocation pleine d’ambiguïté des souffrances et des amours de l’adolescence. Proche du Bloomsbury Group, auteure de L’Invitation à la valse, La Ballade et La source, elle sera l’une des grandes figures de la littérature anglaise ;
 Tout le Royaume-Uni sait que les corgis de la reine Elizabeth II ont aussi bon caractère que leur maîtresse. Lors d’une promenade matinale, un bibliobus, garé derrière les jardins de Buckingham Palace, devient la cible de leurs aboiements furieux. La Reine d’Angleterre, soucieuse de ses sujets, pénètre dans le bibliobus et, pour ne pas paraître grossière, repart en ayant emprunté un ouvrage, au grand étonnement du bibliothécaire. Et parce que Elizabeth II traite avec sérieux toutes les affaires, qu’elles soient publiques ou privées, elle, qui ne lit jamais, met un point d’honneur à lire ce livre avant de le rendre au prochain passage du bibliobus. De cette façon l’incident sera clos avec toute la dignité qui sied à la famille royale. Oui mais voilà… quand elle revient au bibliobus, elle ne peut s’empêcher d’emprunter à nouveau un ouvrage…
Tout le Royaume-Uni sait que les corgis de la reine Elizabeth II ont aussi bon caractère que leur maîtresse. Lors d’une promenade matinale, un bibliobus, garé derrière les jardins de Buckingham Palace, devient la cible de leurs aboiements furieux. La Reine d’Angleterre, soucieuse de ses sujets, pénètre dans le bibliobus et, pour ne pas paraître grossière, repart en ayant emprunté un ouvrage, au grand étonnement du bibliothécaire. Et parce que Elizabeth II traite avec sérieux toutes les affaires, qu’elles soient publiques ou privées, elle, qui ne lit jamais, met un point d’honneur à lire ce livre avant de le rendre au prochain passage du bibliobus. De cette façon l’incident sera clos avec toute la dignité qui sied à la famille royale. Oui mais voilà… quand elle revient au bibliobus, elle ne peut s’empêcher d’emprunter à nouveau un ouvrage… Norbert, le narrateur, retrouve par hasard l'un de ses vieux camarades, John Mac Corjeag, qui une dizaine d'années auparavant, fut interné à la suite d'une crise de démence. A sa demande, John lui raconte dans quelles circonstances il en est venu à perdre la raison...
Norbert, le narrateur, retrouve par hasard l'un de ses vieux camarades, John Mac Corjeag, qui une dizaine d'années auparavant, fut interné à la suite d'une crise de démence. A sa demande, John lui raconte dans quelles circonstances il en est venu à perdre la raison... nouvelles de Poe.
nouvelles de Poe. Quel drôle d’ovni a atterri dans la hotte du père Noël : un livre sur la cité interdite, écrit par un auteur japonais.
Quel drôle d’ovni a atterri dans la hotte du père Noël : un livre sur la cité interdite, écrit par un auteur japonais.
C’est avec curiosité, mais aussi avec méfiance que je me suis saisie des deux gros volumes de ce roman ambitieux. En effet, curieuse de voir ce qu’un auteur japonais avait à dire là-dessus, et méfiante face à la quatrième de couverture qui annonçait de la fantaisie, de l’ésotérisme même, sur une toile historique. L’histoire n’allait-elle pas être trop fantasque, voire trop romancée ? C’est ce que je me suis demandée en la lisant.
Le roman s’inscrit dans le dernier tiers du règne de l’impératrice Cixi (Tseu Hi) et se concentre sur les événements et les personnages autour de la Réforme des Cent jours. Cela permet à l’auteur de nous plonger dans la Chine traditionnelle avec ses rites de 5000 ans d’âge et de nous amener au seuil de sa difficile mutation vers la modernité.
Si les craintes se sont en partie réalisées, j’ai été déçue plutôt en bien : dans le premier volume, "Le mandat du ciel", l’auteur nous plonge dans l’histoire « transversale » : ainsi, on accompagne l’ambitieux mais naïf Tchouen Youn chez les eunuques et les faiseurs d’eunuque et, au travers de scènes très crues, explorons ce système cruel qui offre aux plus désoeuvrés une chance de prestige inimaginable comme esclave dans la Cité Interdite. Le réalisme de l’écriture et le charisme des personnages tient véritablement le lecteur en haleine. Parallèlement, un deuxième personnage tout aussi charismatique, Liang Wensiou, nous plonge, lui, dans le système des examens impériaux et le monde des mandarins. Passionnant ! Je ne plaisante pas !
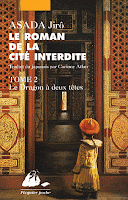 En compagnie de ces deux héros, le lecteur va alors explorer l’opposition entre les réformateurs (Liang Wensiou ainsi que des personnages historiques comme Kang Youwei ou Sun Yatsen) et le camp des conservateurs en compagnie de l’eunuque favori de l’impératrice, le personnage fictif de Tchouen Youn. C’est sur cette opposition que le deuxième volume, Le dragon à deux têtes, se base. En compagnie de personnages historiques, on quitte le monde de la fiction et l’on suit l’histoire linéaire, avec par ci, par là quelques interventions romancées ou fantaisistes qui rajoutent au mystère. Moins passionnant, ce deuxième volume perd de son charme mais permet en revanche de s’intéresser de plus près à l’histoire du court règne de Tsai Tien, le neveu de l’impératrice, et à sa réforme des Cent jours. Autrement dit, aux courants de pensées réformistes de l’époque. Et c’est là que l’auteur perd de sa force : cette pensée n’est pas explorée en profondeur, on reste plutôt au niveau des intrigues, et c’est bien dommage.
En compagnie de ces deux héros, le lecteur va alors explorer l’opposition entre les réformateurs (Liang Wensiou ainsi que des personnages historiques comme Kang Youwei ou Sun Yatsen) et le camp des conservateurs en compagnie de l’eunuque favori de l’impératrice, le personnage fictif de Tchouen Youn. C’est sur cette opposition que le deuxième volume, Le dragon à deux têtes, se base. En compagnie de personnages historiques, on quitte le monde de la fiction et l’on suit l’histoire linéaire, avec par ci, par là quelques interventions romancées ou fantaisistes qui rajoutent au mystère. Moins passionnant, ce deuxième volume perd de son charme mais permet en revanche de s’intéresser de plus près à l’histoire du court règne de Tsai Tien, le neveu de l’impératrice, et à sa réforme des Cent jours. Autrement dit, aux courants de pensées réformistes de l’époque. Et c’est là que l’auteur perd de sa force : cette pensée n’est pas explorée en profondeur, on reste plutôt au niveau des intrigues, et c’est bien dommage.
En revanche, grâce à quelques scènes qui nous projettent au XVIIème siècle, l’ombre du passé s’étendant sur la Cité, j’ai fait une merveilleuse découverte : un trésor. Le peintre de cour Lang Shining, connu aussi sous le nom de Giuseppe Castiglione ! Ce génie du baroque qui s’était embarqué pour la Chine tout jeune, comme missionnaire jésuite, et qui a passé toute sa vie comme peintre à la cour de l’empereur de Chine. Je suis allée voir ses œuvres sur Internet : à couper le souffle. Je sens là une histoire passionnante et vais faire de plus amples recherches. Merci Asada Jiro pour cette fabuleuse découverte !